|
14-01-2026
-------------------------------------------
Navigation
Previous / Home / Heading / Next
-------------------------------------------
https://www.habiter-autrement.org/ > Genre-Habitat Sexué
--------------------------------------
Femmes
et Ville
Ville de Montréal
Anne MICHAUD - Québec
L’expérience de la Commission Femmes et ville de la
Ville de Québec vue de l’intérieur
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1997-v10-n2-rf1656/057943ar/
www.cafsu.qc.ca/membres.htm
1. Genre et mobilité / Montréal
A Montréal, les évaluations ont permis
d’arriver à la conclusion que les femmes représentaient grosso modo
de 30 à 40% des personnes itinérantes. Ceci déterminé, on a établi
une corrélation entre la proportion d’itinérantes et les ressources
disponibles. La recherche exploratoire a permis de constater un déséquilibre
important entre les ressources destinées aux femmes itinérantes et
celles destinées aux hommes itinérants. Elles a aussi permis une prise
de conscience : les itinérantes et itinérants n’ont pas nécessairement
besoin du même type de ressources. Une stratégie de redressement sera
mise en place. Dans un premier temps, on veillera à répondre aux
urgences, dans un second on ajustera les ressources en conséquence.
Synthèse du «guide d’enquête sur la sécurité des femmes en
ville »
Depuis 1989, au moyen du dossier Femmes et Ville, la ville de Montréal
a entrepris des actions visant l’amélioration de la qualité de vie
des Montréalaises. La sécurité des femmes dans les lieux publics a
particulièrement retenu l’attention des divers services municipaux.
En juin 1992, la ville s’est associée à plusieurs groupes de femmes
organismes communautaires et institutions publiques pour fonder le CAFSU
(Comité d’action femmes et sécurité urbaine). L’objectif en est
de promouvoir la sécurité des femmes dans la région de Montréal.
Ces expériences et les conclusions des divers travaux peuvent servir
utilement de modèle à d’autres contrées.
L’environnement sécuritaire selon les femmes permet :
- de savoir où l’on est et où l’on va
- de voir et être vue
- d’entendre et être entendue
- de pouvoir s’échapper
- d’obtenir du secours
A partir d’un guide d’enquête (novembre 1993), résultat du
projet-pilote mené par le Service des loisirs, des parcs et du développement
communautaire de la ville de Montréal, il est possible d’analyser son
propre quartier ou environnement afin de faire des suggestions d’amélioration.
Pour dépasser le seuil des impressions générales, les facteurs de
l’environnement à considérer sont par exemple :
- la signalisation
- l’éclairage
- les cachettes
- les prévisions de déplacement
- l’achalandage
- l’obtention de secours
- l’entretien
- l’aménagement
Sous l’appellation globale ou initiale de « marche exploratoire »,
une intéressante méthode de réunion, d’analyse, d’action est décrite
avec fiches détaillées, démarches et lettres types, adresses des
organisations à contacter. Les démarches écrites ou orales
s’adressent aussi bien aux citoyens (suggestions d’aménagement
externe : tags, fenêtres cassées…) qu’aux pouvoirs publics.
Ce guide peut être
utilisé pour l’amélioration de la sécurité des lieux publics tels :
-les rues résidentielles et commerçantes, les ruelles
-les stationnements
-les viaducs
-les parcs, les sentiers piétonniers
-les arrêts d’autobus, les stations de métro
-les édifices publics
soit tous les endroits où on ne se sent pas l’aise pour circuler.
Ce guide a servi à la réalisation de centaines de marches
exploratoires dans la ville de Montréal. Le but est de vivre dans un
environnement propre et accueillant, il passe par le fait « d’agir
ensemble ».
Acquis :
- ampagnes de sensibilisation
- Intégrer les critères
d’aménagement sécuritaire à la rénovation des sorties et abords
des stations de métro. Les sorties des métros montréalais avec façades
vitrées assurent une visibilité et un sentiment de sécurité accrus
pour qui y entre et en sort, surtout le soir
- Actions régionales ont abouti au service de descente « entre deux
arrêts » de la STCUM, suite à la demande de groupes de femmes.
Ce service permet aux femmes et aux filles de descendre entre deux arrêts
en soirée afin de se rapprocher de leur destination.
- Développement des relations internationales en matière de sécurité
des femmes : Montréal comme chef de file, séminaire international
en 2002.
Responsable programme Femmes et ville : Anne Michaud, 333 rue
Saint-Antoine Est, Bureau 212A, Montréal, Québec, H2X 1R9 courriel :
anmicho@ville.montreal.qc.ca
Conclusions et suggestions – éléments de synthèse
et de conseils :
- Rendre la ville plus sécuritaire pour les femmes, c’est aussi
rendre la ville plus sécuritaire pour l’ensemble de la population.
- Il importe de travailler avec les pouvoirs publics afin que les futurs
et présents aménagements tiennent compte des éléments révélés
importants lors d’évaluations, appels d’offres, octrois de
contrats, etc. Importance de la conscientisation du personnel municipal
qui participe à l’entretien de la ville
- Les principes de l’aménagement sécuritaire ont été développés
dans plusieurs villes canadiennes (Toronto, Ottawa) à partir des
facteurs ayant une incidence sur la sécurité et le sentiment d’insécurité
des femmes. Voir guides d’aménagement sécuritaire (stationnements et
ensembles résidentiels).
- Mobiliser les institutions ainsi que les diverses communautés, les
quartiers et voisinages face à la problématique de la sécurité des
femmes en milieu urbain.
- Après la campagne « J’accuse la peur « ,
le Cafsu crée un précédent dans domaine de la sécurité des femmes
en milieu urbain par le fait qu’il réalise une alliance entre
des groupes de femmes, d’organismes communautaires et d’institutions
publiques.
- Inciter les hommes à assumer leurs responsabilités et agir contre la
violence masculine exercée à l’endroit des femmes.
- Combattre la violence en commençant par la prévenir, comme les
incendies. Il faut instruire les enfants, mobiliser la population,
inciter les femmes à marcher en groupes dans les parcs, occuper les
espaces publics, briser les préjugés (une femme de bonnes mœurs ne se
promène pas seule la nuit dans les parcs). Exemple de défi idéal à
atteindre: qu’une femme puisse faire de la méditation seule dans un
parc au clair de lune.
- Plutôt que d’institutionnaliser la sécurité urbaine, la remettre
entre les mains des gens du quartier. Que les journaux locaux et les
radios communautaires parlent des actions menées pour donner aux résidents
le goût de s’engager personnellement.
- La société n’enseigne pas le respect de l’autre et la violence
ne peut que s’intensifier si l’on ne modifie pas le système social
que les femmes doivent contribuer à changer de l’intérieur.
- Faciliter l’intégration des immigrantes et rechercher les affinités
entre les femmes.
- Se faire connaître de son entourage et établir une surveillance
entre les voisins avec qui on se lie plus difficilement dans les grandes
villes qu’en banlieue.
- Former un réseau d’entraide entre gens du quartier. Travailler de
concert avec la police pour redonner confiance dans ses services.
- Développement d’un sentiment d’appartenance à leur quartier.
- Publication par un groupe d’hommes d’un dépliant à l’intention
des hommes sur les moyens de contrer la violence.
- Instaurer des patrouilles
d’agentes de police comme cela se
fait au Brésil.
- Une association de Toronto suggère un couvre-feu imposé aux hommes
certains soirs afin de permettre aux femmes de sortir en toute sécurité,
l’aménagement de parcs conçus à l’usage des femmes ou des hommes
accompagnés de femmes. Faut-il aller jusque là ? Pourquoi pas…
- Transformer les mentalités afin d’éliminer la violence sous toutes
ses formes. Ceci permettrait d’éviter diverses mesures. Eduquer les
garçons sur le problème de la sécurité des femmes.
- Encourager la mixité des groupes, les alliances entre les hommes et
les femmes ou les groupes qui les représentent.
- Sévérité des peines en cas d’agression sexuelle, insistance sur
leur caractère criminel dans les campagnes publicitaires.
- Les femmes doivent s’intégrer aux structures politiques pour une
plus juste représentativité.
- Participation des femmes et des filles à des cours d’autodéfense.
Moyens à retenir et à préconiser :
- Les marches exploratoires responsabilisent citoyens et pouvoirs
publics (accompagnées idéalement d’un(e) policier(e)
- 60.000 dépliants, 6.000 affiches dans métro, municipalités, palais
de justice, sûreté du Québec, journalistes, participants d’ « agir
pour une ville sans peur », abribus. Bon moyen de conscientisation
et, idéalement, de responsabilisation.
- Commerçants secours : réseau de commerçants conscientisés,
apposant une affichette signifiant qu’ils soutiennent et accueillent
toute femme en situation d’insécurité ou d’agression dans la rue.
- Les femmes ne peuvent changer les hommes. Seulement, faire alliance avec
eux.
Echanger, véritablement.
- C’est à chaque personne de veiller à sa propre transformation.
- Si, dans les messages télévisés, on mettait l’accent sur le respect
comme valeur, on en verrait les résultats positifs.
- En guise de clin d’œil,
on peut se demander si, pour cause de non respect du plein droit d’accès
des femmes aux espaces publics (sécurité), les citoyennes ne devraient
pas suivre la suggestion de ne pas payer leurs taxes municipales.
Documents :
CAFSU répertoire des activités montréalaises « Agir
ensemble pour la sécurité des femmes »
Plus de 100 initiatives répertoriées organisées par divers organismes
montréalais.
Une ville à la mesure des femmes. Le rôle des municipalités dans
l’atteinte de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes.
Femmes et ville. Montréal. Octobre 1997.
Agir pour une ville sans peur. Actes du forum. Montréal. Novembre 1993.
Guide d’enquête sur la sécurité des femmes en ville. Ville de Montréal.
Novembre 1993.
2. Rapport de la commission consultative Femmes et ville - Québec
Le département québécois de la sécurité des femmes a réalisé le
programme « Aux portes des cités sûres » de 1992 à 1994.
L’objectif était d’instaurer une collaboration entre les groupes féministes
et les responsables municipaux.
Suite aux enquêtes et actions menées auprès des femmes à Québec même
ou dans les villes
environnantes, « aux portes des cités sûres », il ressort
que :
L’insécurité augmente dans les endroits trop ou trop peu fréquentés.
Solutions proposées :
- Améliorer l’éclairage.
- Installation de téléphones d’urgence avec une attention particulière
pour les malentendants qui ne peuvent les utiliser.
- Il importe de veiller à maintenir ou instaurer une diversité de
population (différents revenus, types de population…)
- On souligne l’importance d’affecter les mêmes policiers à un
quartier (connaissance de la population) et de veiller à l’aspect préventif
et éducatif de leur travail.
- Il est proposé de mener des campagnes de sensibilisation au civisme
en insistant sur le respect : - des piétons- de la propriété –
de la quiétude des habitants – de la propreté.
Soulignons que trois femmes sur cinq ne se plaignent pas des agressions
qu’elles subissent ! D’où l’importance de l’écoute et de
l’attention à ces plaintes pour ne pas provoquer d’autres problèmes
(crainte, agressivité, rancœur…).
En ce qui concerne la sécurité dans les transports en commun à
développer :
- Signaler par des affiches voyantes dans les transports en commun qu’il
est interdit de harceler.
- Installer un dispositif d’alarme permettant d’entrer en contact avec
le chauffeur pour signaler une agression dans le transport en commun
(existe dans le métro de Toronto).
- Installer un dispositif de plainte dans les bureaux administratifs des
stations de transport, inciter à les contacter pour dissuader les
agresseurs potentiels.
- Instaurer un poste de responsable à la sécurité féminine à la ville
(commune)
- Etablir une formation à l’attention des chauffeurs de taxis et aussi
pour les conducteurs des transports en commun afin qu’ils soient des
relais et des aides potentiels pour les victimes d’agression.
- Accorder une attention particulière à la vitesse de conduite, de
freinage, attendre que les personnes âgées soient assises pour démarrer.
- Multiplier les barres d’appuis dans les transports.
- Attention particulière aux poussettes, voitures d’enfants.
- Développer un réseau de coopératives de voitures (car sharing) comme
cela existe dans certaines villes (Allemagne, Suisse…)
Cyclisme, piétons :
- Développer l’usage du cyclisme et favoriser les piétons au
centre des villes, diminuer le nombre de voitures.
- Installer des parkings pour vélos sécurisés (nombreux vols)
- Allonger le temps de passage pour les piétons aux passages réservés
à cet effet
Les automobilistes ne respectent pas nécessairement ces passages, ils
ne sont pas donc pas sécurisés, contrairement à ce que l’on peut
croire.
- Installer des bancs plus nombreux aux abribus notamment.
- Eclairer les abribus.
- Les situer dans des endroits fréquentés, de même pour les terminus
des transports le plus souvent déserts, donc insécurisants.
- Développer le système de couplage bus ou métro + taxis (appel par le
chauffeur du transport en commun). En 1996, le développement québeccois
de la sécurité des femmes a conçu et implanté le projet Taxi Plus à
Granby. Ce projet a mobilisé 60% des chauffeurs de taxi et de
nombreuses ressources de la municipalité. Les chauffeurs ont reçu une
formation visant à apporter une attention particulière à la sécurité
des femmes dans les rues et interviennent en cas de besoin.
- Faire en sorte que les taxis soient clairement identifiables, même de
l’intérieur (plaque libellant l’identité, le numéro).
- Veiller à ce que les policiers circulent à pied ou en vélo (plus de
proximité, d’accessibilité).
- Regrouper les services directs à la population. Les femmes ont
souligné combien il serait intéressant que les services qui les
touchent directement soient regroupés et administrés par la Ville,
comme les écoles, les services de garde, les logements sociaux ou les
programmes d’habitation.
Intéressante suggestion dans notre pays où les compétences et les
administrations sont si éparpillées !!!!
Elles veulent aussi que la ville développe la vie démocratique et
établisse un climat de collaboration entre la population et
l’administration.
Ce que femme veut…. ; vœux pieux ???
- Veiller aussi à l’aspect développement économique. Des cercles
d’emploi pour les femmes viennent en aide au financement des
entreprises de ces femmes !!!
- Collaboration municipale, proche des citoyennes.
- Créer une page Web pour faciliter les liens avec les citoyennes et les
groupes de femmes. Le site internet permet de connaître les services
municipaux, les activités se déroulant sur le territoire de Québec
ainsi que les instances auxquelles s’adresser.
Documents :
Document de consultation – Commission consultative Femmes et
ville.
Ville de Québec. 1994.
Commission consultative Femmes et ville- Audience publique- Recueil des
mémoires. 3 mai 1994.
Rapport de la commission consultative Femmes et ville- Pour une
meilleure qualité de la vie des femmes dans la ville de Québec- Ville
de Québec- 16 mai 1995.
Commission consultative Femmes et ville. Bilan 1995-2000 et priorités
d’action. Québec. Septembre 2000. Responsable programme Femmes et ville :
Anne Michaud
courriel :
anmicho(AT)ville.montreal.qc.ca
-----------------------------------------------------------------------------
Le Comité d'action femmes et sécurité urbaine (CAFSU)
Ce comité voit le jour en septembre 1992, quelques
mois après la Conférence montréalaise sur les femmes et la sécurité urbain
"J'accuse la peur". La Comité est mis sur pied afin d'assurer le suivi des
engagements pris par le Secrétariat d'État du Canada, la Ville de Montréal et la
Communauté urbaine de Montréal (CUM) pris lors de cette conférence.
La mission du CAFSU est d'accroître la sécurité des femmes en milieu urbain,
notamment par la réduction des occasions d'agression ; la neutralisation des
agresseurs ; la renforcement du sentiment de sécurité des femmes par des
stratégies concrètes et le renforcement de l'autonomie des femmes.
Pour ce faire, le CAFSU développe des partenariats avec des organismes du milieu
et des institutions ; mobilise les institutions et les différentes communautés,
les quartiers et les voisinages face à la problématique de la sécurité des
femmes en milieu urbain ; incite les hommes à assumer leurs responsabilités et à
agir contre la violence masculine exercée à l'endroit des femmes ; mène des
recherche et des projets en plus de développer des outils de formation et de
sensibilisation au plan local, régional et international.
Lors d'une réunion tenue le 6 mai 2004, les membres du CAFSU ont décidé de
terminer les projets en cours et de fermer le CAFSU en date du 30 juin 2004.
Les demandes adressées au CAFSU en matière de sécurité des femmes et
d'aménagement sécuritaire ont été prises en charge par le Centre de prévention
des agressions de Montréal (CPAM)
https://archivesdemontreal.ica-atom.org/comite-daction-femmes-et-securite-urbaine-cafsu
La sécurité des femmes, le défi relevé par Montréal
Québec: le programme Femmes et Ville en 1989, le Comité d’action femmes et
sécurité urbains (Cafsu) en 1992
« Je préfère ne pas sortir le soir. Je ne me sens pas assez en sécurité. » Ce
sentiment exprimé par une Montréalaise est rarement pris à la légère. Depuis les
années 1980 en effet, la ville de Montréal et ses partenaires se sont lancés
dans une politique au long cours visant à prendre en compte les besoins
spécifiques des femmes dans le domaine de la sécurité.
Un arsenal de mesures, adapté au fil du temps, qui démontre une volonté profonde
de protéger un groupe majoritaire et pourtant souvent oublié. « Il ne s’agit pas
de mettre de côté les autres citoyens, souligne Rabia Chaouchi, conseillère en
développement communautaire au sein des services de la ville. Mais on considère
qu’un endroit sûr pour une femme le sera pour les autres populations : hommes a
fortiori, mais aussi enfants, personnes âgées ou à mobilité réduite… »
Une volonté inspirée des Nations Unies – La démarche de la ville se fonde
aujourd’hui sur un outil appelé ADS (analyse différenciée selon les sexes).
Adoptée en 1995 dans le programme d’action de la conférence mondiale des Nations
Unies sur les femmes à Pékin, l’ADS a pour objet de discerner de façon
préventive les effets distincts sur les populations féminine et masculine que
pourra avoir la mise en place d’un projet.
Elle peut mener à une offre d’actions différentes faites à l’une et à l’autre.
Pour que cet outil ne soit pas qu’un voeu pieux, il implique l’adoption de
mesures larges telles que la présence de femmes aux postes de décision privés ou
publics, la reconnaissance de celles-ci dans la vie économique et sociale, la
mise en avant des femmes en représentation…
L’un des instruments les plus aboutis de la politique de la sécurité pour les
femmes est constitué des marches exploratoires. Ces inspections d’un territoire
délimité sont déclenchées par les remarques, les craintes, les plaintes
exprimées par des citoyens, avec en qualité d’experts les personnes directement
concernées : les habitants.
« Si une personne nous dit qu’elle n’ose pas traverser le parc qui est en face
de chez elle, nous estimons qu’il y a quelque chose à faire, explique Brigitte
Chrétien, conseillère en sécurité urbaine pour le programme municipal Tandem.
Nous organisons alors avec un groupe de femmes du quartier une marche
exploratoire en journée et en soirée pour étudier ce qui déclenche cette peur.
Le parc n’est pas destiné uniquement à être regardé ! »
Tout y passe : les éclairages défectueux, les recoins, les commerces peu
accueillants, les angles morts… Sur la base de ce rapport, Tandem signale aux
services concernés les améliorations à apporter pour accroître le sentiment de
sécurité des habitants.
Sensibiliser tous les acteurs de la ville – Les pouvoirs publics sont les
premiers avisés des changements souhaitables, mais le privé n’est pas en reste.
Les commerçants ont ainsi été encouragés ces dernières années à apposer sur leur
devanture le signal « Ici, vous êtes entre de bonnes mains », indiquant à une
personne nécessitant de l’aide qu’elle pouvait se réfugier à cet endroit.
Les commerçants participants ont reçu au préalable une formation sur la manière
d’accueillir une personne dans cette situation.
Ces actions de prévention sont renforcées par une collaboration étroite entre
les différents services de protection des citoyens : police, élus et Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels (Cavac).
Chaque entité alerte les autres lorsque c’est nécessaire. Tandem propose, par
exemple, des visites à domicile, afin de prodiguer des conseils de mise en
sécurité d’un logement à la suite d’une effraction.
« Par ailleurs, pour rassurer les citoyens, nous proposons des ateliers de
conseils en sécurité et des cours d’autodéfense. L’objectif est de donner les
outils à la fois physiques et psychologiques pour oser profiter du quartier, de
la ville, explique Brigitte Chrétien. Une attention particulière est portée sur
ce point aux femmes à mobilité réduite, plus enclines que les autres à craindre
de ne pouvoir réagir à un acte de violence éventuel. »
Penser aux femmes SDF – Au-delà de cette vision globale, les politiques de
sécurité à destination des Montréalaises se déclinent en plusieurs volets, plus
spécifiques.
Les femmes sans domicile fixe, par exemple, bénéficient d’une attention
particulière. « On a observé que les femmes vivant dans la rue avaient des
besoins différents de ceux des hommes, indique Guy Lacroix, conseiller en
développement communautaire de la ville de Montréal. Par exemple, concernant
leur logement de secours, elles préfèrent avoir un studio avec plusieurs
espaces, pour dormir, pour recevoir… Les hommes, eux, ressentent peu ce besoin
de séparation. On cherche à respecter ces différences. »
Autre exemple d’action ciblée : la sécurité des jeunes filles dans les relations
amoureuses. Menés dans une maison des jeunes de l’est de la ville, ces 12
ateliers s’adressent aux filles âgées de 12 à 17 ans.
Tous les lundis, elles se retrouvent pour discuter et s’informer sur des sujets
variés : les gangs de rue, la sexualité, les relations amoureuses, l’hypersexualisation,
l’autodéfense…
« Il n’y a pas de cours sur ces questions à l’école, regrette Stéphanie Boucher,
responsable de l’animation. D’où l’importance de ces ateliers, qui permettent
aussi l’échange entre grandes et petites et qui font d’elles des relais
d’information ».
Une manière d’armer les femmes de demain face au sentiment d’insécurité, et face
à l’insécurité tout court ..
Concrètement, cette volonté s’est traduite par la mise en place de plusieurs
structures dédiées aux femmes : le programme Femmes et Ville en 1989, le Comité
d’action femmes et sécurité urbains (Cafsu) en 1992, le Conseil des
Montréalaises en 2004…
https://www.lagazettedescommunes.com/123550/la-securite-des-femmes-le-defi-releve-par-montreal/
---------------------------------------------------------------------------
L’expérience de la Commission Femmes et ville de
la Ville de Québec vue de l’intérieur
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1997-v10-n2-rf1656/057943ar/
Sentiment d'insécurité - Montréal - Enquête sur le développement de
politiques institutionnelles visant à prévenir le sentiment d'insécurité et la
violence faite aux femmes sur le territoire de la CUM / Comité d'Action Femmes
et Sécurité Urbaine - Edited by CAFSU. Montréal - 1997
La sécurité des femmes, le défi relevé par
Montréal - Québec: le programme Femmes et Ville en 1989, le Comité d’action
femmes et sécurité urbains (Cafsu) en 1992
https://www.lagazettedescommunes.com/123550/la-securite-des-femmes-le-defi-releve-par-montreal/
Women's Safety Audits PDF-56p - What Works and Where? UN Habitat 2008 -
Author: Women in Cities International - Under the direction of: Marisa Canuto,
Executive Director, Women in Cities International
http://www.owl.ru/win/women/org001/women_safety_audit.pdf
A City Tailored to Women PDF-56p: The Role of Municipal Governments in
Achieving Gender Equality - 2004 - An Invitation to Municipalities in Canada and
Abroad - Femmes et Ville Québec
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/guide/a-city-tailored-to-women-the-role-of-municipal-governments-in-achieving-gender-equality-wilg.pdf
Safer Cities Programme, UN-HABITAT P.O. Box 30030-00100 Nairobi, Kenya
E-mail: safer.cities@unhabitat.org
www.unhabitat.org
-------------------------------------------
Navigation
Previous / Home / Heading / Next
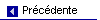 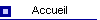 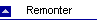 
-------------------------------------------
...www.habiter-autrement.org
> Genre-Habitat Sexué
Contact pour HA: lreyam@gmail.com

https://www.habiter-autrement.org/ |