|
14-01-2026
-------------------------------------------
Navigation
Previous / Home / Heading / Next
-------------------------------------------
https://www.habiter-autrement.org/ > Construction
--------------------------------------
Les maisons
à patio
Les maisons
à patio: Continuités historiques, adaptations bioclimatiques et
morphologies urbaines - Samir Abdulac - Vice-président d’ICOMOS France
abdulac@@@wanadoo.fr
http://openarchive.icomos.org/1160/1/II-1-Article6_Abdulac.pdf
Maison à
Patio, maison à cour, maison été-hiver
Maisons de bassin
méditerranéen
Par Joan Salvat-Papasseit
Source : http://www.meda-corpus.net/libros/pdf_livre_atm/atm_frn/02-atm_frn.pdf
http://www.meda-corpus.net/libros/pdf_livre_atm/atm_frn/01-atm_frn.pdf
http://www.meda-corpus.net/libros/pdf_livre_atm/atm_frn/00-atm_frn.pdf
Extrait du livre
"Architecture Traditionnelle Méditerranéenne"
Ce projet est financé par le
programme MEDA de l'Union Européenne.
Maison élémentaire
Maison compacte/complexe
Maison à patio
Maison à cour
Maison à jardin
Maisons hiver/été
Maison et défense
Maison évolutive/définitive
Maison nomade/troglodytique
Extraits :
MAISON A PATIO
Depuis l’Antiquité le
patio apparaît ou se transfère dans toutes les grandes civilisations
méditerranéennes. En effet ce wested-dar (le centre de la maison) des
peuples arabo-musulmans a déjà centré la maison en Mésopotamie, en
Egypte, en Phénicie, en Etrurie, chez les Grecs et les Romains (dont la
domus, probablement déjà héritière de synthèses indo-européennes,
laissera l’influence de son code dans le Moyen-Âge tant latin qu’arabo-musulman)...
Patio qui a d’ailleurs été une référence de tout premier ordre
pour les grands architectes du XXe siècle et que Mies van der Rohe
notamment incorpore avec sagesse. Le parcours que chacune de ces
maisons, à différentes époques, a fait pour y parvenir n’a pas
été certes le même : peut-être depuis le iwan probablement anatolien
pour les Etruriens, ou dans le sillage des millénaires maisons d’Ur
pour la maison grecque à Priène. L’expression finale à laquelle
chaque culture est parvenue pour exprimer ce coeur domestique a été
aussi teintée de toutes les couleurs. Il reste cependant une même
vocation, un même esprit, un même sentiment que les mots de Georges
Marçais pourraient nous faire approcher : « On est chez soi dans la
maison, on est chez soi dans la cour, avec un morceau de ciel qui n’appartient
qu’à vous. » Le patio ne cache rien, il met en valeur l’intimité
et se connecte avec le ciel, le spirituel, le cosmos. Il défend l’intériorité
autant que, dans l’Antiquité, il aidait à créer l’espace
rassurant, domestiqué, dans un paysage aux mille horizons inconnus et
toujours secoués.
Les deux exemples ci-après,
maison de la Casbah d’Alger et maison à Chefchaouen (Maroc), nous
montrent deux traits importants. Dans le cas de la Casbah (1), la force
de la tradition et des mœurs locales où, bien que l’on puisse
retrouver des traces et gestes turcs, c’est le local qui l’emporte
au moment de modeler la maison qui, sous la contrainte d’espace du
site, grimpe avec grâce et singularité vers le ciel. Dans le cas de l’exemple
du Maroc (2), cette architecture que l’on pourrait appeler d’aller
et retour, transitant entre le Maghreb et l’Andalousie, nous montre,
harmonieusement composées, couplées jusqu’à quasiment se fondre,
toutes les traces de ces riches métissages méditerranéens.
MAISON A COUR
Ce n’est pas un hasard si
une langue précise comme le français n’a pas hésité à accueillir
le mot patio pour nuancer cet écart, parfois très subtil, parfois
très net qui existe entre cour et patio. On retrouve toujours la même
vocation de confiner un morceau d’extérieur et de le rendre
particulier, mais le résultat est nettement moins dense et certainement
plus ambigu. Certains aspects déterminent et renforcent ces
différences :
– l’échelle qui déforme
autant les matérialités (corps du bâti, bâtis/individus,... que les
immatérialités (regards, voix,...),
– la position parfois
décentrée de la cour par rapport au bâti (ce qui complique, voire
empêche, la relation d’égalité et d’équilibre entre les
différents espaces et individus),
– la présence d’une
clôture (c’est-à-dire l’absence de la continuité du mur à
habiter, comme Hassan Fathy définissait les pièces entourant le
patio),
– la promiscuité et la
quantité des activités (agricoles, productives) qui s’y déroulent
comme celle des individus (personnes, animaux) qui y cohabitent (ce qui
génère une modulation toute différente et singulière),
– et finalement le
traitement de cet espace, du point de vue de sa composition comme de sa
texture.
La cour, aussi bien dans l’exemple
de la ferme à Chypre (1) (où la clôture, plus que le bâti, devient
décisive pour dessiner la cour) que dans la maison en Jordanie (2)
(maison à cour quasi-patio), reste une expression très commune dans
toutes les régions et un geste sans équivoque de la volonté d’apprivoiser
l’extérieur et de récréer un espace propre. Même dans les
constructions légères, également dans les nomades, ce besoin se
manifeste et diverses solutions sont mises en oeuvre pour y satisfaire.
La cour reste certes l’évolution du geste primitif que tout homme
essayait, à l’aide de quelques cailloux, branches,... pour rendre
personnel un morceau de l’anonyme espace total.
MAISON A JARDIN
Malgré les pluies maigres et
irrégulières de beaucoup de zones du Bassin aux paysages souvent
assoiffés, le jardin, les arbres, les fleurs et l’exubérance de
couleurs et parfums domestiqués ont été depuis l’Antiquité
associés à l’habitat méditerranéen de façon plus ou moins
excellente ou discrète. Depuis les jardins de Babylonie, que les Grecs
considérèrent comme l’une des Sept Merveilles du monde, en passant
par les jardins tant parfumés que productifs de la maison égyptienne,
par ceux accolés au péristyle romain ou par les grands jardins des
villas d’été des pachas ou des raïs dans le Maghreb, la maison
méditerranéenne apprivoise d’abord l’espace, puis le
Méditerranéen y répand couleurs et arômes. L’économie
traditionnelle trouve dans ce jardin, souvent plus grand en surface que
la maison, la jouissance, une efficace régulation bioclimatique, mais
aussi sa survie. Des légumes, des végétaux, des plantes qui
guérissent et toujours des fruits étoffent et complètent cette oasis
particulière.
La maison à jardin de Mugla,
Turquie (1), ci-après, et en général la maison turque déclinent
parfaitement cette notion de jardin complet dans ses fonctions et
généreux en beauté et en exubérance. La maison s’élance sur le
jardin à travers son sofa qui ouvre la maison tous azimuts sur
celui-ci. Ce n’est sûrement pas un hasard si c’est en Turquie que
cette maison à jardin, qu’elle soit modeste ou noble, s’exprime
avec plénitude. Les influences des civilisations situées au-delà de
la Méditerranée orientale n’y sont pas pour rien. Les jardins de
soie des tapis, les beaux carrelages floraux ou les miniatures
coloriées des livres médiévaux perses, où la maison à jardin
représente le « paradis », nous indiquent une source généreuse.
Soliman le Magnifique, sous la direction de qui une remarquable
synthèse des traditions turques, islamiques et européennes a été
produite par ses artistes et penseurs, écrivait : « ... si tu espères
être admis au jardin du Paradis pour y trouver l’amour et la grâce.
»
MAISONS HIVER/ETE
« L’été, la tente est
trop chaude, les flij donnant de l’ombre mais n’arrêtant pas la
chaleur. Aussi les semi-nomades la plient et lui préfèrent une hutte
légère faite de diss sur une carcasse de branchages, le khoçç. Ainsi
avons-nous rencontré près de Bir Amir 17 khoçç de la fraction des T
rarma installés là au mois d’août, alors que nous les avions
trouvés vingt kilomètres à l’est et sous la tente, fin mars. » Ces
quelques lignes d’André Louis illustrent richement cette minutieuse
adaptation de la maison méditerranéenne aux saisons mêmes. Depuis l’Antiquité,
nombre de documents ont décrit la maison d`été, la maison de
campagne, souvent contrepoint des mondes rural et urbain. Pline
écrivait dans ses Epistolae : « ... Pas de protocole, pas d’impertinents
à la porte, tout est tranquille et calme, la bonté du climat rendant
le ciel plus serein et l’air plus pur, je sens mon corps plus sain et
mon esprit plus libre... » Bien que très loin du cadre luxueux de
Tusci décrit par l’historien romain, les exemples de Ghardaïa en
Algérie (1. 2.) et de Sfax en Tunisie (3. 4) nous ramènent aussi à
une ambiance où le calme, la jouissance et un certain relâchement des
mœurs et de la rigidité urbaines sont fortement présents et rendent
le moment de cette transhumance saisonnière attendu et désiré.
Notons dans le cas de
Ghardaïa la déformation que subit le plan de la maison d’été.
Installée en plein cœur de la palmeraie, que les mozabites ont créée
en faisant pousser depuis le premier jusqu’aux plus de sept cent mille
palmiers actuels, la maison s’adapte et surtout se profile à travers
ces palmiers en les respectant, les intégrant souvent dans le patio.
Ils deviennent ainsi des habitants à part entière, chéris et gâtés.
Dans le cas de Sfax, la
maison d’été, en campagne, loin de la protection de la médina et
dans ce cas de ses remparts rassurants, prend elle-même la forme d’une
forteresse. Son nom en arabe, bordj, renvoie à cette idée de
fortification. Son volume compact, ses façades quasiment closes autant
que ses franchissements voûtés définissent sans ambiguïté cette
idée. Dans les deux cas, bien que porté à la surface minimale, le
patio reste omniprésent.
++++++++++++++++++++++++++
La maison urbaine à patio,
réponse architecturale aux contraintes climatiques du milieu aride chaud
http://www.jle.com/e-docs/00/04/8C/12/article.phtml
Auteur(s) : Meriama
Bencherif, Salah Chaouche, Université Mentouri Département
d’architecture et d’urbanisme Laboratoire Urbanisme et environnement
Campus Hamani Route Aïn El-Bey 25000 Constantine Algérie.
Résumé : Les performances climatiques des formes urbaines dans les
régions arides chaudes commencent à l’échelle de la ville, pour se
poursuivre à celle du bâti qui assure la protection, l’inertie et
l’ombre. Parmi les éléments régulateurs figure le patio, omniprésent du
Maroc à la Chine. Sous ses diverses formes, il constitue un modérateur
du microclimat intérieur des habitations. Pourtant, la maison à patio a
été délaissée et critiquée. Son abandon s’est fait au profit de modèles
réputés plus urbains, mieux ancrés dans la tradition occidentale. Si cet
article réhabilite quelque peu cette forme architecturale, c’est que,
par ses qualités intrinsèques d’adaptation au climat désertique, elle
mérite des applications plus étendues et un réajustement approprié, dans
le cadre d’un habitat individuel dense et groupé, indépendant de
l’héliocentrisme.
Mots-clés : bioclimat, développement durable, maison à patio, milieu
aride
Auteur(s) : Meriama Bencherif meriama60@yahoo.fr, Salah Chaouche
salahchaouche@yahoo.fr
Université Mentouri Département d’architecture et d’urbanisme
Laboratoire Urbanisme et environnement Campus Hamani Route Aïn El-Bey
25000 Constantine Algérie
Tirés à part : M. Bencherif
L’homme a toujours cherché à se protéger des rigueurs du climat en
créant à l’intérieur de son habitat les conditions d’un relatif confort.
Les populations soumises à des conditions extrêmes ont été, dans
l’histoire, de remarquables inventeurs de dispositifs architecturaux
adaptés au milieu, comme l’igloo de l’Eskimo, la maison sur pilotis du
Malais ou la maison à patio du sud de la Méditerranée. Dans tous les
cas, l’adaptation aux conditions climatiques a suivi un long processus,
où des éléments culturels et religieux se sont insensiblement mêlés au
patrimoine technique reposant sur un savoir empirique (Izard et Guyot,
1979). Mais qu’est devenu l’enseignement des Anciens ? Trop souvent le
présent l’ignore, au profit d’un recours irréfléchi à la technologie et
à l’air conditionné, censé compenser les excès du climat local en
faisant abstraction de la nature. Pourtant, si l’on veille à intégrer
les exigences actuelles dans les conceptions traditionnelles, nombre de
ces dernières ont encore toute leur place dans une architecture
contemporaine soucieuse du lieu sur lequel elle s’édifie.
De fait, on trouve dans l’architecture vernaculaire du domaine aride
chaud des techniques de construction ancestrales (Frey, 2010), fondées
sur les énergies naturelles, qui permettent aux bâtiments de répondre au
contexte climatique. Bien que la chaleur soit difficilement supportable
en été dans le désert, les habitants jouissent à l’intérieur de leurs
demeures de conditions de vie confortables, grâce à une bonne
compréhension du milieu et à une adaptation réussie à ses contraintes.
Plutôt urbaine que rurale, la maison à espace central ouvert, ou patio
(Edwards et al., 2006 ; Rabbat, 2010), représente au Sahara la forme
architecturale type, d’autant qu’elle est favorisée par l’usage de
matériaux locaux isolants, adaptés au climat, tels que le toub (brique
sèche), le timchent (plâtre traditionnel, de couleur grise, obtenu à
partir d’un gypse hydraté de la Chebka, utilisé pour le parement ou le
remplissage) et le béton de terre stabilisée, ou BTS (Bencherif, 1996).
Les pages qui suivent se proposent de rassembler quelques réflexions sur
la maison urbaine à patio, avec un triple objectif : cerner ses
avantages pour le contrôle de l’environnement domestique, essayer de
comprendre pourquoi elle est tombée dans un relatif discrédit et tracer
les contours de l’évolution qui devrait la faire revenir en grâce. La
majorité des exemples seront fournis par le Sahara algérien, les autres
étant empruntés au Proche et au Moyen-Orient.
L’homme et les contraintes du milieu aride chaud
La station d’In Salah, au centre-sud du Sahara algérien (27° 23’ N, 02°
46’ E, 269 m), peut aider à caractériser le milieu aride chaud,
largement déterminé par la présence presque permanente des anticyclones
subtropicaux (Pagney, 1994 ; Warner, 2004). Des rayons solaires faisant
avec l’horizontale un angle toujours fort, un trajet atmosphérique de
ces rayons plus réduit qu’à de plus hautes latitudes et une très faible
nébulosité font que, nuit et jour confondus, les températures moyennes
annuelles atteignent un niveau très élevé (25,4 °C). Mais si l’été est
torride, une certaine fraîcheur règne en hiver : les températures
moyennes mensuelles s’échelonnent de 13,0 °C en janvier à 36,5 °C en
juillet. En outre, le contraste moyen entre le jour et la nuit est assez
élevé (14,7 °C en janvier, 15,6 °C en juillet). Mais, dans ce contexte
plus que n’importe où à la surface du globe, les dispositions moyennes
ne donnent qu’une image très imparfaite du climat car les extrêmes
peuvent, de temps à autre, prendre des valeurs considérables (Péguy,
1970). D’une part, les latitudes subtropicales arides possèdent les
points les plus chauds de la planète (55 °C à Kébili, dans le Sud
tunisien, le 7 juillet 1931). D’autre part, la limpidité de l’air
favorise un taux élevé de rayonnement nocturne, au point que la
température baisse quelquefois de 30 °C en quatre ou cinq heures ; il
s’ensuit que, certaines fins de nuits d’hiver, le thermomètre descend
sous abri au-dessous du seuil de gel, surtout en altitude (jusqu’à - 10
°C dans le Tibesti, - 7 °C à Tamanghasset, - 6 °C à Béchar et Béni Abbès).
À ces excès thermiques s’ajoutent une humidité relative très basse aux
heures les plus chaudes, au moins dans les endroits les plus marqués par
la continentalité, une radiation solaire intense et des vents
desséchants, souvent chargés de sable ou de poussières. En outre, au
sein d’un air à ce point voué à la subsidence, les précipitations ne
peuvent être que rares et très irrégulières : à In Salah, la lame d’eau
moyenne annuelle, calculée sur la période 1973-2012, ne dépasse pas 33,6
mm, avec des extrêmes de 0 et 224,9 mm.
La recherche du confort thermique
Pour assurer le confort de l’habitat dans un tel milieu aride chaud, on
cherche avant tout à se protéger des radiations solaires et à obtenir
les meilleures conditions de ventilation (Mazria, 2005).
Dans le désert, le « contrôle » du rayonnement solaire est un des
éléments majeurs des choix urbanistiques et architecturaux (Le Quellec
et al., 2006). On admet en général que les procédés utilisés génèrent
une ambiance interne confortable lorsque l’écart thermique avec
l’extérieur atteint une dizaine de degrés (Hyde, 2008). La préoccupation
dominante est de donner aux constructions l’orientation et la forme qui
sont les plus aptes à les faire bénéficier des variations saisonnières
du soleil, en position et en intensité, tout en répondant aux besoins de
chauffage, de climatisation, de ventilation et d’éclairage. Laisser le
soleil pénétrer à l’intérieur de l’habitation, pour y stocker sa
chaleur, permet d’élever la température ambiante en hiver ; voiler son
rayonnement par un écran assure rafraîchissement et ventilation en été ;
combiner les deux, donc exposer et cacher alternativement, c’est
réaliser la régulation thermique la plus simple et la plus efficace (Alexandroff
et Alexandroff, 1982). On tire le meilleur parti de l’ensoleillement en
jouant sur la géométrie, sur les propriétés thermo-physiques des
matériaux utilisés, sur l’organisation intérieure, sur le nombre et la
dimension des ouvertures, ainsi que sur diverses protections, fixes ou
mobiles (Hurpy, 1978 ; Hyde, 2008). Toutes les parois pouvant être
ensoleillées, et le but du pare-soleil étant de minimiser les apports
calorifiques, sa disposition varie avec l’angle d’incidence du
rayonnement solaire1 pour atténuer son ardeur (Wright, 1979).
La direction des vents est variable, mais au Sahara les secteurs NW à NE
et SW à SE ressortent comme les plus fréquents, ce qui reste compatible
avec une façade orientée vers le sud, sachant que cette orientation
permet à une construction d’être ventilée par un vent de nord-est. Dans
ces conditions, l’orientation idéale est, sensiblement, nord-sud (Givoni,
1978).
Si l’isolation est un moyen de lutte contre le transfert de chaleur de
l’extérieur vers l’intérieur (Dumitriu-Valcea, 1986), l’inertie
thermique2 permet d’intervenir sur les échanges, cette fois, de
l’intérieur vers l’extérieur. Elle est d’autant plus grande que le bâti
est à la fois massif et bien isolé. Cette inertie présente un réel
intérêt au Sahara, pendant l’été, parce qu’elle uniformise la
température de la face interne du mur (ou de la terrasse), tout en
réduisant les variations thermiques diurnes ; ainsi, la température
maximale de la paroi intérieure se trouve abaissée. L’inertie atténue
aussi le cycle diurne thermique extérieur, en y introduisant un
déphasage : on peut vivre dans des pièces fraîches le jour (grâce à
leurs murs épais3, éventuellement enduits de chaux) et les quitter la
nuit quand les murs commencent à radier, pour aller séjourner dans une
pièce à faible inertie, voire sur la terrasse (stah) ; on parle alors
d’un « nomadisme quotidien » ou d’un « nomadisme interne ».
Fezzioui et al. (2012) ont par exemple calculé qu’à Béchar, toutes
choses égales par ailleurs (nature, épaisseur et revêtement des murs
extérieurs aussi bien que des cloisons, de la toiture, du plancher et
des vitrages, niveau d’occupation, horaires d’ouverture des fenêtres…),
des températures supérieures à 34 °C régnaient pendant 550 heures/an
dans les chambres d’une maison de type moderne et seulement pendant 206
heures dans une maison à patio.
Lorsque la toiture est une coupole ou un dôme, ce qui est fréquent par
exemple dans la région du Souf et dans la ville iranienne de Yazd, sa
superficie est multipliée par trois en comparaison d’une terrasse plate.
Dès lors, ne recevant que le tiers de radiation par unité de surface,
elle se réchauffe moins vite et se refroidit plus rapidement, par
émission vers l’atmosphère. Quant à la ventilation nocturne, elle
rafraîchit les structures internes des bâtiments.
Il va de soi que ces différents procédés sont souvent combinés entre
eux. Ainsi l’air du patio, éventuellement rafraîchi par l’eau et la
végétation, pénètre-t-il dans les pièces de séjour orientées au nord ;
l’air chaud est alors repoussé en haut des pièces et il s’échappe par
les ouvertures qui y sont ménagées ; des variantes existent avec le
concours des tours à vent, dont on reparlera plus loin (Izard, 1993).
Pour l’ombrage, la compacité est de rigueur
La première adaptation au climat est réalisée par la densité du bâti et
par les contours extérieurs des bâtiments, qui aident à se soustraire
aux températures extrêmes (Bardou et Arzoumanian, 1978). Le tissu urbain
se caractérise alors par une grande compacité, verticale et horizontale,
qui expose une surface minimale au soleil d’été et aux vents froids
d’hiver. Les ruelles, longues et sinueuses, sont ombrées presque toute
la journée (figure 1). Les maisons à patio sont agglomérées densément et
leurs murs mitoyens limitent la surface exposée. Parfois, l’étage est en
encorbellement au-dessus des ruelles, ce qui permet de régulariser le
plan des pièces ou de les agrandir aux dépens de la rue. Celle-ci voit
alors son ombrage renforcé, tandis que diminue encore le temps
d’ensoleillement des façades et que le vent devient incapable de chasser
l’air frais nocturne (figure 2).
Dans un environnement dense, il y a peu d’espace pour les tourbillons de
poussières, pour le sable et pour le rayonnement solaire direct ou
diffus, qui sont les trois contraintes majeures auxquelles la population
doit faire face dans de tels climats (figure 3). Certes, à l’intérieur
du domaine aride, les caractéristiques spécifiques de l’habitat varient
en fonction du climat régional, des traditions et des matériaux locaux.
Cependant, une constante est la présence de logements vastes, sur
plusieurs niveaux, où l’on ne voit jamais directement le jour. Il est en
outre plus avantageux d’y accoler les maisons les unes aux autres, de
façon à réduire sensiblement les surfaces ensoleillées. Mais la rareté
des ouvertures impose la présence d’un « espace extérieur » enclos dans
la maison (Izard, 1976).
Stratégie de la maison à patio en tant que régulateur thermique
La maison à patio a une longue histoire : des vestiges d’espaces
centraux ouverts ont été datés d’il y a environ 8 000 ans, au nord-ouest
de Téhéran (Memarian et Brown, 2006). Aujourd’hui, du Maroc à l’Inde et
à la Chine, les maisons à patio témoignent de réelles ressemblances,
même si elles varient sur certains détails – ce qui explique que la
langue arabe n’ait pas de mot unique pour la désigner : wast el dar, ard
el diar, hoch, fanaa… (Abdulac, 2011). Le cas de la vallée du M’Zab a
été souvent décrit (Ravéreau, 2003) : dans les cinq cités alignées le
long du lit de l’oued, Ghardaïa, Melika, Beni-Izguen, Bou-Noura et El
Atteuf, la maison type (figure 4), de couleur claire, a une inertie
thermique considérable, avec très peu d’ouvertures sur l’extérieur ;
elle est dotée d’une terrasse, utilisée la nuit en été ; un arbre au
coin du patio lui donne de l’ombre et retient l’humidité, symbole de vie
dans le désert.
Avec sa configuration en forme de cuvette, le patio, autour duquel
viennent s’articuler la cuisine et les chambres, est l’ultime protection
d’un espace privé ouvert contre les températures extrêmes, les vents
chargés de poussières et les tempêtes de sable. La femme y évolue à son
aise. Répondant au besoin oriental d’introversion, le patio est ombragé
une grande partie de la journée, il se comporte comme un régulateur
thermique, car la fraîcheur nocturne ne s’y estompe qu’en début
d’après-midi (Raydan et al., 2006). Le rôle de la cour et le rapport
entre sa largeur et sa hauteur varient selon les régions et le degré
d’aisance. À Fès, Alger ou Tunis, la maison à patio est toujours à
l’ombre en été, car la hauteur du patio est supérieure à sa longueur
(figure 5). Mais le patio peut aussi se situer à l’étage, la pièce
inférieure n’étant alors éclairée que par une petite ouverture (raouzna)
au plafond ; ce dispositif (chbek) est fréquent au M’Zab (Ravéreau,
2003).
Les façades sont mutuellement protégées du rayonnement solaire par les
habitations qui leur font face. Grâce à ces projections géométriques et
à une orientation soigneusement étudiée, la maison à patio réalise un
système idéal de défense contre l’environnement aride chaud. Ainsi, la
majorité des patios au Sahara sont orientés NE-SW et SE-NW. Ces
directions à 45 degrés sont optimales pour produire de l’ombre en été,
tout en permettant l’ensoleillement en hiver (Ginefri, 1987).
Entre nomadisme et procédé spécifique
Pour être à l’abri du soleil, la partie estivale de la maison ksourienne
fait face au nord-est. La face opposée sert à profiter du soleil en
hiver. Le patio, entouré de hauts murs comme un puits, est ombragé en
été ; la nuit, lorsque l’ambiance se refroidit, il emmagasine de l’air
frais qu’il restituera dans la journée, pour quelques heures. Ainsi, des
espaces différents peuvent-ils être occupés à différentes périodes du
jour ou de l’année. La mobilité quotidienne s’inverse d’une saison à
l’autre. En été, pour les activités diurnes, les habitants utilisent le
rez-de-chaussée, plongé dans l’ombre ; la nuit, ils passent sur les
terrasses pour profiter du rayonnement infrarouge vers le ciel clair.
Ainsi, par les émissions terrestres et les brises, l’air frais nocturne
descend peu à peu et pénètre dans le patio, envahissant tous les
espaces. La masse thermique de la structure absorbe cette fraîcheur et
la retient jusqu’à la mi-journée. Entre-temps, la cour irradie la
chaleur absorbée, le jour, vers le ciel, et le patio devient un espace
d’activité, le soir, puis une chambre, la nuit.
À la mi-journée, quand le soleil est haut, ses rayons pénètrent
directement dans le patio. L’air frais stocké dans la structure massique
s’élève alors, et crée un courant d’air provoquant un certain confort.
Quand la température extérieure est élevée, la masse thermique des murs
en pisé, adobe ou timchent retarde jusqu’au soir la pénétration de la
chaleur dans les chambres. Dès la tombée de la nuit, la température
décroissant vite, les habitants trouvent le bien-être dans le patio, où
l’air frais commence à descendre. Et le cycle recommence…
L’usage de la terrasse est complété par divers espaces couverts qui
s’ouvrent sur le patio, mais leurs fonctions diffèrent selon les régions
: galerie, loggia, sabat4 ou iwan5 (figure 6). Ainsi, après la réduction
des fortes températures par la diminution des surfaces exposées au
soleil et par la répartition des pièces, d’autres procédés et
dispositifs viennent améliorer la protection thermique.
L’intégration architecturale dans la climatisation naturelle
Les méthodes traditionnelles de rafraîchissement naturel utilisent des
procédés variés : contrôle du rayonnement solaire, rafraîchissement par
convection, évaporation, radiation et conduction6. Il était naguère
habituel que ces différents procédés soient utilisés de manière hybride,
seule la combinaison de plusieurs systèmes de rafraîchissement
permettant d’obtenir un effet suffisant. Certes, ces dispositifs,
adoptés pour améliorer les conditions de confort climatique interne en
les intégrant architecturalement, ne sont pas spécifiques aux maisons à
patio ; mais c’est là qu’ils ont été le plus ingénieusement mis à
profit.
Le rafraîchissement par convection utilise l’air frais nocturne accumulé
dans la masse thermique du bâtiment et le restitue le lendemain. La
captation de l’air externe peut se révéler profitable en été, si on
l’humidifie au passage (Givoni, 1978).
Répandu dans l’ensemble du monde islamique, le moucharabieh7 (claustra)
est une ouverture en panneaux ajourés de bois ou de gypse, qui permet de
voir sans être vu tout en favorisant la ventilation naturelle sur les
façades extérieures et la pénétration de la lumière diffuse, moins
agressive pour l’œil que le rayonnement direct. L’air chaud, tendant à
s’élever, est remplacé par de l’air frais en créant un courant d’air
sans qu’il y ait besoin de vent à l’extérieur. La réduction de la
surface produite par le maillage du moucharabieh accélère le passage du
vent. Celui-ci est alors mis en contact avec des surfaces humides,
bassins ou plats remplis d’eau qui diffusent leur fraîcheur à
l’intérieur de la maison. Les fenêtres donnant sur le patio sont larges
: celle du haut permet l’évacuation de l’air chaud, celle du bas descend
jusqu’au sol (figure 7). Ainsi à Damas, l’air très chaud rentre dans la
maison à travers le patio où il est rafraîchi par évaporation (plantes
et fontaines) ; puis l’air frais pousse l’air chaud accumulé dans la
maison et l’évacue à travers de petites percées, ce qui forme un circuit
d’air en conjonction avec les portes et les fenêtres (Fardeheb, 1989).
La cheminée d’air est un autre système destiné à profiter des vents
frais dès qu’ils soufflent. Très répandue en Iran, en Irak et en Égypte,
attestée plus marginalement dans d’autres pays, elle est orientée en
direction du vent dominant et s’élève sensiblement au-dessus des
terrasses, afin de profiter du moindre filet d’air, de ne pas souffrir
de l’obstruction des bâtiments adjacents et de réduire la poussière (Bahadori,
1978). Ce procédé peut être monodirectionnel et orienté vers le nord (au
Caire, par exemple), comme il peut être bidirectionnel ou
multidirectionnel (dans les pays du golfe Persique). Appelé malqaf ou
badgir, ce système de refroidissement passif consiste en une ouverture
munie d’un conduit en bois, en métal ou en brique, incliné à 45 degrés
vers le vent dominant qui s’engouffre dans le conduit, expulsant l’air
chaud accumulé dans le patio après être passé à travers les pièces
(figure 8). L’air extérieur capté par ces « tours à vent » est plus
frais et moins chargé de poussières que l’air au niveau du sol.
Rafraîchi par les parois intérieures du conduit, cet air descend dans
les pièces habitées en chassant l’air chaud qui s’y trouvait. La nuit,
en l’absence de vent, la tour agit comme une cheminée, dirigeant cette
fois l’air chaud vers l’extérieur, alors que pénètre par les fenêtres
l’air frais du patio. Une jarre en terre cuite (mazaria), remplie d’eau,
élève l’humidité relative de l’air (Hurpy, 1978).
Le rafraîchissement par évaporation apporte une sensation de fraîcheur,
que l’eau provienne de fontaines, de bassins, de l’arrosage du patio ou
d’autres dispositifs d’humidification. Ainsi, en domaine aride, l’eau et
la végétation sont présentes à tous les niveaux de l’aménagement de
l’habitat, de la ville noyée dans la palmeraie au simple oranger planté
dans le patio. Par ailleurs, en tant que structure radiative, la maison
à patio permet le rafraîchissement par conduction et par radiation
nocturne, en créant un courant d’air avec les ouvertures (Wright, 1979).
De la tombée en désuétude à la réhabilitation de la maison à patio
En tant que leçon du passé, le potentiel architectural saharo-arabique a
été peu à peu négligé et les bouleversements socio-économiques qu’il a
subis ont affecté son exploitation. Par conséquent, une politique de
conservation représente une nécessité absolue, dans des pays où
l’architecture vernaculaire perd de son identité et où sa survie devient
une urgence.
Le patio, en tant qu’espace où se regroupait la famille élargie
(occupation unifamiliale des lieux), présentait de multiples qualités
qui sont aussi bien d’ordre climatique, organisationnel que social, à la
différence de la « cour urbaine » à l’européenne, qui s’adapte bien au
logement collectif en jouant un rôle plus technique que social, car elle
perd de sa centralité fonctionnelle au profit de l’extraversion de la
maison.
Cependant, quel langage en faveur des maisons à patio serait adapté à la
société saharienne d’aujourd’hui ? Comment combiner l’habitat
individuel, qui reste prisé par l’immense majorité de la population,
avec la recherche d’une densité élevée du tissu urbain ? Comment faire
d’une maison à patio une authentique « maison de ville » ? Comment
renouer avec les meilleures solutions passives, pour répondre au
problème de 1’adaptation au climat ? Comment concilier les désirs
d’intimité et d’appropriation de la maison avec celui de l’urbanité ?
L’habitat à patio, comme source de satisfaction ou de frustration,
est-il encore une aspiration ou une attente (positive ou négative) ? En
tout cas, il ne faut pas confondre patio central et cour : le premier
est actif, la seconde est passive. L’originalité du patio, qui fait sa
force mais aussi son ambiguïté, c’est d’être à la fois « dedans et
dehors », d’être ouvert quand bien même il est couvert (dans le cas du
patio à portique et à auvent).
Le patio comme régulateur du climat et rôle social
Le patio est très impliqué dans l’organisation spatiale de la maison. La
faiblesse des plans modernes, en milieu aride chaud, est souvent de
reproduire les classiques schémas linéaires occidentaux, en les
flanquant d’un simple jardin intérieur : d’où, par opposition aux
maisons « à » patio, les maisons « avec » patio – et la dérive
inévitable vers le patio « bocal » décoratif en appendice. Mais dès que
l’on veut faire jouer à cet espace un rôle permanent dans le mode de vie
des habitants, on se heurte au problème climatique.
Même si elle suppose certaines prouesses technologiques, la couverture
transparente amovible n’est pas un « gadget », car elle amplifie les
qualités de la maison à patio et s’approprie en permanence le patio,
grâce aux apports solaires d’hiver. Paradoxalement, c’est le recours aux
dispositifs les plus sophistiqués de l’architecture bioclimatique qui
devrait désormais concourir à l’implication du patio. Ce dernier doit
garder son caractère ambigu de séjour à ciel ouvert, mi-intérieur
mi-extérieur, carrefour d’une vie familiale qu’il faut recréer, si l’on
veut retrouver l’ambiguïté des patios traditionnels et éviter le
caractère réducteur du patio moderne. Souvent, celui-ci n’est qu’un
espace extérieur indépendant de la maison, un lieu de passage plus qu’un
lieu d’habitation et de vie. C’est cette ambiguïté qui confère à la
maison à patio sa souplesse d’utilisation, en la différenciant d’une
simple maison à cour (Abdulac, 2011).
Entre compacité du tissu à patio et nécessité d’une vraie façade
À l’inverse des assemblages modernes qui restent souvent linéaires, les
tissus urbains traditionnels optimisent la densité pour constituer des
îlots compacts et épais, dont l’effet de masse confère aux maisons une
bonne inertie thermique. Là encore, les dispositifs vernaculaires
rejoignent les préoccupations actuelles de l’architecture bioclimatique.
En revanche, l’accès des îlots aux véhicules y est difficile et conduit
à un enclavement des maisons, ce qui implique des adaptations passant
par une réhabilitation du système à îlots. En fait, la transposition des
modèles traditionnels ne peut se faire car elle nécessiterait
l’occidentalisation des modèles, lesquels sont souvent trop connotés
culturellement pour qu’une telle évolution soit acceptée par la
population (Bencherif, 2007).
Les transformations des modèles anciens devraient donc corriger les
défauts relevés, et conduire à un renouvellement radical. Il s’agit
avant tout de compenser la tendance flagrante des maisons à patio à
constituer des espaces publics résiduels dans les ensembles modernes.
Cette tendance, suggérée ou réelle dans les villes sahariennes, résulte
de la priorité qu’a le centre de la maison par rapport à sa périphérie.
Si, à l’inverse, on décide de privilégier le tracé urbain et l’espace
public, il faut éviter une démarche « centrifuge » et prédéterminer les
formes de l’espace public urbain et des patios qui paraîtront, ainsi, «
recreusées » dans la masse continue des bâtiments. C’est ce que nous
appelons la démarche « soustractive », qui apporte une certaine garantie
d’urbanité (Nicolas et Rémon, 1981).
Il est vrai que, dans la tradition urbaine saharienne, si l’on excepte
le système soukier avec la mosquée, la rue présente souvent un aspect
répulsif et sans vie, du fait que toutes les maisons lui tournent le dos
sans offrir de vraies façades. D’où la nécessité de compenser l’aspect
étanche et l’absence d’individualité de la maison à patio, en lui
conférant une « vraie » façade sur la rue. C’est une opération délicate,
car elle s’oppose à l’esprit des modèles traditionnels, à leur
introversion. Ce n’est pourtant qu’à ce prix que les structures
spatiales des maisons à patio pourraient être conciliées avec le désir
aujourd’hui impérieux de « donner sur la rue ». Il s’agit en fait de
constituer une maison à patio biface et de rééquilibrer les relations
entre les espaces intérieurs, patio compris, et la rue ; en d’autres
termes, il s’agit de trouver le dosage subtil entre intimité et
sociabilité. Toutefois, on peut accentuer l’adaptation de la maison à
patio, qui paraît apte à répondre aux exigences les plus actuelles en
matière d’habitat, notamment, avec le bioclimatisme8.
Par sa morphologie, la maison à patio se prête aisément à des
combinatoires de groupements dont elle serait la « cellule de base », en
permettant des associations multidirectionnelles en raison de son
important linéaire de mitoyenneté aveugle. Le danger de ce système est
de ne pas contrôler la forme et l’échelle de l’espace public urbain,
d’où l’effet d’un tissu expansionniste, « proliférant », largement
critiqué.
Vers un réajustement de l’appropriation du patio
La maison saharienne actuelle ne s’inspire guère de l’ancienne, qui
savait jouer avec le vent et le soleil. Son « patio », éclairé par un «
puits de lumière », devient un « hall » tandis que, par son magasin et
son garage, elle affiche l’aisance du propriétaire. Les fenêtres donnant
sur la rue sont occultées d’une tôle plastique ondulée, car elles
extériorisent l’intimité. Ainsi, au lieu du jeu subtil de terrasses
multiples disposées à différents niveaux permettant à chacun de dormir
isolément l’été, on n’a plus qu’un vaste dortoir collectif. La réalité
est que cette terrasse n’a plus d’intérêt, puisque les chambres sont
climatisées. N’était-il pourtant pas possible de concevoir une
architecture contemporaine qui reste fidèle aux coutumes sahariennes,
qui sache s’adapter aux rigueurs estivales tout en s’affranchissant de
cette technologie fragile et coûteuse qu’est la climatisation ? Certains
ksouriens semblent commencer à prendre conscience du gâchis. Mais il
leur est difficile de lutter contre une vague destructrice qui se
confond avec une volonté de modernisme mal compris. Que reste-t-il du
dialogue entre permanence et altération ? Car détruire ces maisons,
témoins du passé, n’est que l’une des facettes d’un processus de
déculturation déclenché par la volonté d’investir dans la rénovation
urbaine ; il est vrai que l’immobilier à usage non lucratif est
aujourd’hui l’un des derniers secteurs refuges pour les capitaux privés.
La maison à patio concilie le bioclimatisme et l’urbain
A priori, telle que léguée par la tradition et lovée sur un puits
d’ombre, la maison à patio paraît adaptée aux grandes chaleurs. À
surface égale, une maison à étage s’avère plus intéressante qu’un simple
rez-de-chaussée. En plus de l’avantage de réduire la surface de la
toiture, la maison à étage permet de résoudre aisément les délicats
problèmes que posent les maisons à patio en termes de distribution
interne des pièces. Par ailleurs, le rayonnement solaire utile, en
hiver, s’en trouve facilité, du fait qu’une maison à patio central est
un des rares modèles architecturaux à favoriser le « self-control » des
effets de masque dans le patio lui-même (figure 9). Nous touchons là,
sans doute, au plus grand avantage du système : sa morphologie
particulière évite tout desserrement du tissu urbain si, par des
artifices de coupe, on réussit à faire bénéficier le patio d’un
ensoleillement convenable. Il semble bien qu’il y ait là une alternative
sérieuse aux tristes ensembles pavillonnaires, auxquels risquait de nous
condamner la politique des lotissements. Bien plus, la maison à patio
permet de déjouer la tyrannie de « l’orientation préférentielle », qui
hante les plans de masse à la recherche du meilleur angle pour capter
les rayons solaires. L’indépendance du patio vis-à-vis de la façade sur
rue l’autorise à adopter une direction quelconque, et reste compatible
avec une implantation libre des masses construites. Ainsi, une maison
sachant concilier deux domaines qui s’ignoraient jusque-là, l’urbain et
le bioclimatisme (Gandemer et Guyot, 1976), c’est une maison qui aurait
deux visages, l’un caché et tourné vers l’intérieur, assumant le climat
mais sachant en tirer profit, l’autre découvert, tourné vers la rue et
la vie sociale.
Aussi les aménageurs doivent-ils aujourd’hui considérer les enjeux
environnementaux du domaine aride chaud, respecter et valoriser les
paysages locaux et méditer les leçons des chefs-d’œuvre anciens, avec
les outils et les méthodes modernes, pour réaliser des formes
architecturales adaptées à ces milieux. L’intervention se fait sur les
formes urbaines, sur les densités, sur les orientations et les
expositions optimales, ainsi que par le recours à la végétation et à
l’eau (figure 10).
Conclusion
Le bilan thermique d’une construction est la différence entre ses
apports et ses déperditions. Pour un comportement équilibré, la
conception de l’enveloppe selon les matériaux utilisés doit fonctionner
comme un filtre régulateur des flux – et non comme une barrière. Peu de
recherches ont été consacrées aux performances thermiques des procédés
utilisés dans l’architecture vernaculaire des pays chauds qui,
aujourd’hui, sont ignorés pour faire place à des systèmes d’air
conditionné, sophistiqués mais onéreux. Vouloir concilier les
problématiques urbaines et bioclimatiques (Mazouz, 2005b) revient à
réconcilier la préoccupation de l’urbanité retrouvée et celle de
l’adaptation du cadre bâti au climat. C’est, en fait, la création des
conditions de confort sans recours à la technologie. Il est à espérer
que les aménageurs redécouvrent au plus vite la richesse et le
bien-fondé de l’héritage architectural des pays chauds et secs. En
effet, la maison urbaine à patio s’est vue délaissée et critiquée. Son
abandon s’est fait au profit de modèles réputés plus urbains, mieux
ancrés dans une tradition occidentale. Si cet article tend à réhabiliter
quelque peu la maison à patio, c’est parce que l’on est convaincu que,
par ses qualités intrinsèques d’adaptation au climat désertique, elle
mériterait des applications plus étendues, en tant qu’habitat individuel
dense et groupé, indépendant de l’héliocentrisme. Il faut remettre
l’architecture climatique au cœur des débats actuels pour le
développement durable.
Références
Abdulac S, 2011. Les maisons à patio, continuités historiques,
adaptations bioclimatiques et morphologies urbaines. In : Icomos. Le
patrimoine, moteur de développement. Paris : International Council on
Monuments and Sites.
http://openarchive.icomos.org/1160/1/II-1-Article6_Abdulac.pdf.
Alexandroff G, Alexandroff JM, 1982. Architectures et climats : soleil
et énergies naturelles dans l’habitat. Paris : Berger-Levrault.
Bahadori M.N. Les systèmes de refroidissement passifs dans
l’architecture. Pour la Science 1978 ; 6 : 14-22.
Bardou P, Arzoumanian V, 1978. Archi de soleil. Roquevaire :
Parenthèses.
Bencherif M, 1996. La ville saharienne, de la tradition à l’innovation.
Mémoire de magister en urbanisme, université de Constantine.
Bencherif M, 2007. La micro-urbanisation et la ville-oasis ; une
alternative à l’équilibre des zones arides pour une ville saharienne
durable. Cas du Bas-Sahara. Thèse de doctorat en urbanisme, université
de Constantine. http://bu.umc.edu.dz/theses/architecture/CHA4965.pdf.
Dumitriu-Valcea E, 1986. Isolation thermique des constructions en
Algérie. Alger : ENL.
Edwards B, Sibley M, Hakmi M, Land P, 2006. Courtyard housing: past,
present and future. London: Taylor & Francis.
Fardeheb F, 1989. Classification des techniques de refroidissement
naturelles dans l’architecture vernaculaire des pays du Moyen-Orient.
Séminaire sur l’énergie solaire, Tlemcen.
Fezzioui N, Benyamine M, Tadj N, Draoui B, Larbi S, 2012. Performance
énergétique d’une maison à patio dans le contexte maghrébin (Algérie,
Maroc, Tunisie et Libye). Revue des Énergies Renouvelables 15 : 399-405.
http://www.cder.dz/vlib/revue/pdf/v015_n3_texte_4.pdf.
Frey P, 2010. Learning from vernacular/Pour une nouvelle architecture
vernaculaire. Arles : Actes Sud.
Gandemer J, Guyot A, 1976. Intégration du phénomène vent dans la
conception du milieu bâti : guide méthodologique et conseils pratiques.
Paris : ministère de la Qualité de la Vie.
Ginefri JM, 1987. La conception climatique des bâtiments en pays chauds.
Travail personnel de fin d’études, École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette.
Givoni B, 1978. L’homme, l’architecture et le climat. Paris : éditions
du Moniteur.
Hurpy I. La climatisation de l’habitat par cheminée solaire et le
système du “Melkaf” solaire. Cahiers AFEDES : énergies nouvelles 1978 ;
5 : 105-110.
Hyde R, 2008. Bioclimatic housing: innovative designs for warm climates.
London : Earthscan.
Imesch T, Thomann HU, 1991. Timimoun, habitat du Sahara. Paris :
Institut du monde arabe.
Izard JL, 1976. L’approche bioclimatique en urbanisme et architecture.
Marseille : Groupe ABC.
Izard JL, 1993. Architectures d’été, construire pour le confort d’été.
Aix-en-Provence : Edisud.
Izard JL, Guyot A, 1979. Archi bio. Roquevaire : Parenthèses.
Le Quellec JL, Tréal C, Ruiz JM, 2006. Maisons du Sahara : habiter le
désert. Paris : Hazan.
Mazouz S, 2005a. Mémoires et traces : le patrimoine ksourien. In : Côte
M, dir. La ville et le désert. Le Bas-Sahara algérien. Paris ;
Aix-en-Provence : Karthala ; Iremam.
Mazouz S, 2005b. L’adaptation bioclimatique dans le Bas-Sahara. In :
Côte M, dir. La ville et le désert. Le Bas-Sahara algérien. Paris ;
Aix-en-Provence : Karthala ; Iremam.
Mazria E, 2005. Le guide de la maison solaire. Marseille : Parenthèses.
Memarian G, Brown F, 2006. The shared characteristics of Iranian and
Arab courtyard houses. In: Edwards B, Hakmi M, Land P, eds. Courtyard
housing: past, present and future. London: Taylor & Francis.
Nicolas F, Rémon M, 1981. Architecture urbaine bioclimatique. I.
Recherche et expérimentation d’un vocabulaire formel spécifique. Paris :
Direction de l’architecture.
Pagney P, 1994. Les climats de la terre. 2e éd. Paris : Masson.
Péguy CP, 1970. Précis de climatologie. 2e éd. Paris : Masson.
Rabbat N, 2010. The courtyard house: from cultural reference to
universal relevance. Farnham (Surrey) : Ashgate Publishing Ltd.
Ravéreau A, 2003. Le M’Zab, une leçon d’architecture. Rééd. Paris ;
Arles : Sindbad ; Actes Sud.
Raydan D, Ratti C, Steemers K, 2006. Courtyards: a bioclimatic form. In:
Edwards B, Hakmi M, Land P, eds. Courtyard housing: past, present and
future. London: Taylor & Francis.
Warner TT, 2004. Desert meteorology. Cambridge: Cambridge University
Press.
Wright D, 1979. Soleil, nature, architecture. Roquevaire : Parenthèse.
1 L’angle d’incidence est celui que forment un flux électromagnétique
direct (ici, le rayonnement solaire) et une surface de réception
quelconque (ici, un pare-soleil). La loi de Lambert enseigne que
l’intensité calorifique par unité de surface varie proportionnellement
au sinus de l’angle d’incidence des rayons solaires : il en résulte que,
sous un angle de 30 degrés, l’intensité calorique est réduite d’environ
moitié par rapport à des rayons verticaux.
2 L’inertie thermique (ou masse thermique) est la capacité physique d’un
matériau à stocker de l’énergie. Plus l’inertie est élevée, plus le
matériau restitue des quantités importantes de chaleur (ou de
fraîcheur), en décalage par rapport aux variations thermiques
extérieures (puisque le matériau met plus de temps que l’air à se
réchauffer ou à se refroidir). En général, plus un matériau est lourd et
plus il a d’inertie. Celle-ci est utilisée en construction pour atténuer
les variations de la température extérieure, pour accumuler le jour la
chaleur qui sera restituée la nuit et, en définitive, pour assurer une
ambiance climatique intérieure aussi confortable que possible.
3 Un mur de faible épaisseur garantirait une certaine fraîcheur dans la
matinée, mais créerait une fournaise l’après-midi car il se serait
saturé de chaleur en une demi-journée, alors qu’un mur plus épais
réalise un déphasage plus long. Il ne s’agit toutefois que d’un
déphasage : l’échauffement n’est pas bloqué, mais seulement ralenti.
Pour diminuer la quantité de chaleur captée par le mur, celui-ci est
laissé blanc, teinte naturelle de l’enduit de chaux qui le protège.
Ainsi revêtu, il réfléchit l’essentiel du rayonnement reçu et n’en
absorbe qu’une petite part.
4 Le sabat est un espace couvert mais ouvert latéralement sur le patio,
une sorte d’espace-tampon entre la cour et les pièces d’habitation. Dans
le Souf, il en existe même deux : l’un orienté au nord et utilisé en
été, l’autre orienté au sud et utilisé en hiver (Mazouz, 2005a).
5 L’iwan, originaire de Perse, typique du Proche-Orient, est un élément
architectural qui consiste en un vaste porche voûté, ouvert d’un côté
sur le patio par un grand arc. Orientés au nord, les iwans restent toute
la journée à l’ombre.
6 La déperdition de chaleur peut se faire par émission d’un rayonnement
infrarouge (radiation), par propagation de molécule à molécule, par
exemple dans l’épaisseur d’un mur (conduction), par transfert de
calories au profit de l’air en contact avec la surface des parois
(convection) ou par transformation de l’eau en vapeur (évaporation),
chaque gramme d’eau qui s’évapore utilisant environ 0,5 calorie.
7 Le kush du Yémen remplit sensiblement les mêmes fonctions.
8 Izard et Guyot (1979) définissent le bioclimatisme comme la « science
tendant à faire remplir par l’architecture elle-même la fonction de
satisfaction des exigences thermiques minimales de l’occupant, de
préférence au recours à l’ingénierie climatique ».
++++++++++++++++++++++++++
Logement
individuel Habiter demain dans des modules d'architecte choisis sur
catalogue ?
par Julien Brengues
Habiter demain dans des
modules d'architecte choisis sur catalogue ?
Quelles sont les évolutions
plausibles et prévisibles pour la maison individuelle ? Julien
Brengues, jeune architecte de l'Hérault, avait choisi pour son diplôme
un sujet casse-cou : maison individuelle et densité. Ses réponses –
habitat modulaire, industrialisation, notamment, sont également
risquées. D'où leur intérêt. Comment construira-t-on demain ?
Mutation des modes de vie, nouveaux usages de l’habitation, évolution
des pièces de vie, nouvelles techniques de construction et
développement durable sont autant d’évolutions déjà observées, et
qui devraient profondément transformer le secteur du bâtiment. Or, on
constate une réelle inertie de celui-ci malgré des recherches
incessantes par des organismes tels que PUCA ou Europan sur les nouveaux
modes d’habiter et de produire la maison, et sa production ne cesse de
stagner.
Cette immobilité commence
même à être assez dérangeante, surtout si l’on observe le
décalage entre les modes de vie de notre société en éternelle
mutation et les lieux de vie de la population.
REPENSER LA MAISON
Concevoir un projet de maison
adapté à un moment donné, mais surtout pouvant évoluer et se
modifier avec la famille est primordial. La maison d’aujourd’hui et
de demain doit pouvoir s’ajuster aux différentes étapes de la vie
familiale. Elle est donc un espace destiné à croître, se modifier et
doit également posséder un fort potentiel d’appropriation et de
maîtrise des espaces. Très en vogue dans beaucoup de pays tels que les
Etats-Unis, le Canada ou la Suisse et l’Allemagne, le logement
préfabriqué et modulaire fonctionne particulièrement bien. De
nombreux exemples existent et leur utilisation se banalise. La mise en
place de sites Internet et de catalogues permet une grande diffusion et
une construction facilitée de ces modules. Le grand inconvénient de
ces typologies est l’idée d’espaces figés et très restreints
provoqués par ces volumes d’habitation .Le concept de modules
servirait alors de volumes intégrant soit les espaces de communs
(cuisine, WC, salle de bain, dressing…), rangements (garage, atelier,
buanderie…), les espaces privés (chambres, dressing, salle de bain,
bureaux personnels…), les espaces de travail (bureau professionnels,
atelier…) ou les espaces de loisirs (salle multimédia, home cinéma…).
Les lieux de vie seraient alors les espaces interstitiels entre les
modules. Ces nouveaux lieux ont une relation privilégiée avec l’extérieur
car ils se trouvent être eux-mêmes en dehors des modules. La conception
d’un catalogue comprenant des volumes pensés pour une situation
donnée (module nuit, enfants, bureau, service, voiture) et d’un
système constructif les accueillant est une solution alternative et
possible. Celui-ci permettrait de choisir, changer et ajouter de
nouveaux espaces tout au long de la vie du bâtiment.
A LA RECHERCHE DE DENSITE
La seule alternative à l’étalement
urbain est sans aucun doute la densité. Mais cette densité a plusieurs
facettes, du logement collectif à la maison en bande. Or, aujourd’hui,
nous savons que le tout collectif n’est pas envisageable, de part l’envie
des futurs acquéreurs mais aussi par les problèmes générés par les
grands ensembles. A ce jour, nous sommes à la recherche de densité
mais les règlementations urbaines mises en place bloquent énormément
la densification du logement individuel. En effet, le fait de pouvoir
développer en limite de parcelle permettrait des espaces de type patio
au cœur même des espaces bâtis. De plus, les constructions basses ne
dérangent en aucun point le voisinage, bien au contraire, elles
permettent de créer des espaces tampons entre elles. Comment convaincre
les futurs acquéreurs du bien fondé de la densification malgré un
terrain plus petit et un logement plus proche voire accolé au
constructions voisines ?Si l’on observe le fonctionnement d’une
parcelle de maison individuelle, on peut voir que l’utilisation de
celle-ci n’est pas complète. En effet, que se soit le fond ou les
côtés du terrain, ils sont peu, voire pas du tout, exploités, donc
inutiles et consommateurs d’espace. Proposer une habitation utilisant
chaque mètre carré du terrain, jusqu’à dire que l’on habite
totalement la parcelle peut être un atout important. Cela voudrait donc
dire que la maison et son terrain ne font qu’un, que le séjour et le
jardin ne forme qu’une seule et unique pièce à vivre…Cette
typologie de lotissements denses situés en zone urbaine couvre environ
le tiers, voire la moitié, de la ville compacte. Celle-ci se perdra
avec les nouveaux moyens de transports et de télécommunications qui
offriront la possibilité d’acheter plus loin, plus grand et moins
cher. Cette manière d’habiter en profondeur de la parcelle et cette
nouvelle typologie de modules permet de proposer une même orientation
à tous les logements et de créer un sens de circulation de l’espace
public à l’espace privé. Plus on s’enfonce dans la parcelle, plus
l’intimité se fait ressentir. La disposition des modules de
rangements (garage...) et de services en continuité sur la rue permet
de procurer une sensation de protection, alors que les modules chambres
se retrouvent dans un espace intime en fond de parcelle.
CONSTRUIRE DIFFEREMMENT
On peut facilement s’apercevoir
que l’homme a réussi à industrialiser pratiquement tous les produits
et objets dont il avait besoin. Aujourd’hui, il lui manque seulement
le logement.
L’industrialisation du
logement permettrait sans doute, de faire baisser les coûts de
construction d’une habitation mais aussi de réduire les temps de
production de ce secteur.
De plus, cela peut également
offrir une meilleure gestion à long terme du parc immobilier, en
travaillant sur des bâtiments entièrement modulables, voire
démontables et réutilisables, ou encore recyclables.
L’ECOLOGIE ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE INCONTOURNABLES
Ce projet a pour obligation
de se confronter aux questions de développement durable et d’écologie.
Cela suppose des réflexions à deux échelles, une première sur le
thème urbain et une seconde sur le bâtiment même. La notion de ville
durable gravite aujourd’hui autour des idées de densité. En
revanche, une forte densité engendre localement une congestion et une
concentration de pollution atmosphérique, une minéralisation accrue du
sol et une augmentation de température, voire une saturation de l’espace
bâti qui peut réduire ses capacités d’évolution. La densité forte
apporte donc des bénéfices à un niveau global mais crée des
contraintes locales importantes.
Ce paradoxe nous invite à
nous interroger sur les moyens d’atteindre la compacité souhaitée et
sur la forme à lui donner. Fixer une densité élevée revient à n’offrir
la possibilité de construire qu’à ceux qui ont des moyens financiers
élevés, ce qui est contraire aux principes d’équité et de
dynamisme économique. Le second thème doit s’appliquer à la
construction en tant que telle. Toutes les questions sur les énergies
passives et actives, les matériaux écologiques, l’impact sur le site
ou l’utilisation de modules préfabriqués doivent être relevées. L’avantage
incontestable de la préfabrication est le plus faible impact généré
sur le site mais aussi l’optimisation en temps, qualité et finition
de l’objet final. Les modules préfabriqués et autostables permettent
de faire évoluer l’habitat sans pour autant produire de gros travaux,
et de réutiliser les modules changés soit en les revendant, soit en
les recyclant. Ceux-ci s’apparenteraient presque au même système de
recyclage des automobiles, des frigos ou des téléviseurs. Des boîtes
parfaitement isolées, additionnées à des éléments préfabriqués
recherchant soit de l’inertie, soit une grande isolation permettraient
de créer des espaces agréables et économes en énergie.
CONCLUSION
L’enjeu de ce travail reste
très vaste car le secteur du bâtiment en général, et de la maison
individuelle en particulier, génèrent beaucoup de questions aujourd’hui.
Les nouveaux usages de la maison, l’évolution des pièces de vie, les
mutations des modes de vie, les nouvelles technologies… n’ont de
cesse de se confronter à un système relativement figé. En effet, les
règlementations du marché de la construction ont tendance à bloquer
toute évolution possible de la maison, ce qui induit une grande inertie
dans le domaine de l’habitation individuelle. Une grande réflexion
commune reste donc à mener, dans laquelle ces contraintes doivent être
gommées ou modifiées afin de tester de nouvelles solutions. Si nous n’évoluons
pas aujourd’hui, un énorme fossé va se creuser entre notre manière
de vivre et notre lieu de vie. Ce travail de fin d’études avait pour
but de relever ces questions, d’en faire une synthèse et de produire
une ébauche de réponse plausible.
-------------------------------------------
Navigation
Previous / Home / Heading / Next
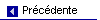 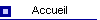 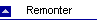 
-------------------------------------------
...https://www.habiter-autrement.org/
> Construction
Contact pour HA: lreyam@gmail.com
 |